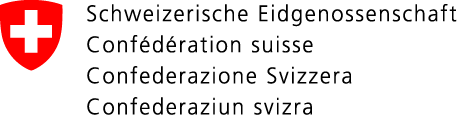Potentiels, coûts et impact environnemental des technologies de production de l’électricité d’ici 2050
Berne, 09.11.2017 - L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) fait régulièrement évaluer les coûts, les potentiels et l’impact environnemental des technologies de production de l’électricité. Les résultats servent de base pour les perspectives énergétiques comme pour le monitoring technologique prescrit par la nouvelle loi sur l’énergie. Sont également examinées des technologies qui n’entrent pas en ligne de compte pour la production nationale d’électricité mais qui pourraient présenter un intérêt pour les futures importations d’électricité. Elaborée par l’Institut Paul Scherrer (PSI) sur mandat de l’OFEN, l’étude publiée aujourd’hui est une version actualisée et complétée de l’étude du PSI de 2005 qui a servi de base à l’élaboration des perspectives énergétiques 2035.
L'étude élaborée par le PSI, également menée dans le cadre du Swiss Competence Center for Energy Research - Supply of Electricity (SCCER-SoE) et du Swiss Competence Center for Bioenergy Research (SCCER BIOSWEET), expose les coûts, les potentiels et l'impact environnemental à l'horizon 2050. Elle ne porte pas sur l'interaction des différentes technologies (aspects systémiques) ni sur les coûts externes (coûts de CO2, p. ex.).
Par rapport à l'étude précédente, le cadre de la présente analyse est nettement plus large. Elle porte sur les technologies suivantes: petites et grandes centrales hydroélectriques, éoliennes (onshore et offshore), installations photovoltaïques, transformation de la biomasse en électricité, centrales géothermiques (pétrothermales), centrales houlomotrices ou marémotrices, installations de production solaires thermiques, centrales nucléaires, centrales au gaz naturel ou au charbon et centrales de cogénération au gaz naturel, piles à combustible et autres technologies «novatrices» (gazéification hydrothermale de la biomasse aqueuse, technologies géothermales non conventionnelles, fusion nucléaire et production de courant thermoélectrique pour une utilisation stationnaire des rejets de chaleur). Alors que la présente étude ne fait pas état de grands écarts en matière de potentiel par rapport à celle de 2005, les coûts des centrales fossiles ont dû être revus à la hausse. En revanche, les coûts du photovoltaïque sont aujourd'hui évalués à un niveau nettement inférieur à celui de 2005. L'étude actuelle contient par ailleurs une analyse systématique de l'impact environnemental basée sur des écobilans.
Potentiel exploitable des énergies renouvelables à l'horizon 2050
Parmi les énergies renouvelables en Suisse, les installations photovoltaïques présentent le plus grand potentiel de développement pour 2035 et 2050 (l'étude ne tient compte que des installations sur toiture). Mais il faut des mesures appropriées permettant d'intégrer dans le système de grandes quantités de courant photovoltaïque issu d'installations décentralisées à la production irrégulière. Les éoliennes ont également un potentiel de développement substantiel pour les deux années de référence. Il en va de même (à long terme, soit à l'horizon 2050) pour la production d'électricité issue de la géothermie profonde. Cette option est toutefois grevée de grandes incertitudes techniques. La production d'électricité à partir de biomasse peut elle aussi augmenter, notamment grâce à l'exploitation énergétique d'une plus grande partie du lisier généré par l'agriculture. Il existe aussi un potentiel de développement non négligeable dans le domaine de la force hydraulique, mais celui-ci dépend toutefois fortement du contexte économique, politique et sociétal.
Coûts de la production d'électricité
L'étude indique les coûts de revient des installations de production d'électricité recourant à des technologies renouvelables (principalement en Suisse) ainsi que ceux des installations conventionnelles de production d'électricité, construites à moyen terme plutôt dans les pays européens. Tandis que les coûts de la force hydraulique, des centrales électriques à bois, des installations de biogaz agricoles et de la production d'électricité fossile devraient augmenter d'ici 2050, les coûts de revient du photovoltaïque devraient diminuer de moitié, un peu moins pour l'éolien. Les prix du charbon et du gaz naturel, principaux agents énergétiques pour la production traditionnelle d'électricité, devraient augmenter de moitié environ d'ici 2050.
Aspects environnementaux
La production d'électricité des centrales hydrauliques, des centrales nucléaires et des éoliennes génère aujourd'hui le moins d'émissions de gaz à effet de serre, alors que l'électricité produite par les centrales à charbon en occasionne le plus. Les émissions de gaz à effet de serre des centrales à cycle combiné au gaz naturel et des centrales à charbon pourraient être réduites de manière substantielle à l'avenir grâce à la capture du CO2. En revanche, les émissions issues de la production d'énergie nucléaire et d'énergie fossile sont appelées à augmenter à l'avenir en raison du manque de disponibilité des agents énergétiques que sont l'uranium, le gaz naturel et le charbon. Grâce aux progrès technologiques, on peut s'attendre à une baisse de l'impact environnemental dû à l'électricité issue d'autres sources.
Le rapport principal a été rédigé en anglais, avec des résumés détaillés en français et en allemand. Un résumé succinct intitulé «Potentiels, coûts et impact environnemental des installations de production d'électricité - synthèse» est disponible en français, en allemand, en anglais et en italien.
Adresse pour l'envoi de questions
Marianne Zünd, responsable Médias et politique OFEN, 058 462 56 75, 079 763 86 11
Liens
Auteur
Office fédéral de l'énergie
http://www.bfe.admin.ch